L’intelligence artificielle, en tant qu’assistant personnel puissant, transforme notre rapport à la production intellectuelle, à l’expression et à la diffusion des idées. Elle ne se contente pas de réduire les frictions inhérentes à la création – qu’il s’agisse d’écrire, d’analyser, ou d’expliquer – elle redistribue aussi les cartes de l’influence et de la légitimité intellectuelle.
[ Temps de lecture estimé à 5 minutes ]

Résumé structuré partageable sur les réseaux sociaux :
🤖 L’IA, outil d’émancipation intellectuelle et accélérateur des transitions
[ ⏱️ Temps de lecture de l’article complet estimé à 5 minutes ]
📚 Longtemps réservée aux experts maîtrisant la rhétorique et le jargon, la légitimité intellectuelle se démocratise grâce à l’intelligence artificielle. En rendant accessibles à tous les outils de structuration, d’analyse et d’écriture, l’IA fait émerger les idées solides et dévoile les discours creux. Elle agit comme un révélateur de sens, recentrant le débat public sur la pertinence des contenus plutôt que sur la technicité des formes.
🚀 Dans le contexte des transitions écologique, sociale ou économique, cette redistribution des moyens d’expression ouvre de nouveaux possibles. Chacun peut désormais contribuer activement, sans être bloqué par des barrières de langage ou des codes réservés à une élite. Pour certains, l’IA pourrait même devenir une chance pour les moins qualifiés, comme le suggère Philippe Silberzahn.
😨 Pourtant, les peurs dominent encore : emploi, deepfakes, consommation énergétique. Mais ces risques ne doivent pas occulter les opportunités. Depuis toujours, les révolutions techniques suscitent l’inquiétude… avant de faire progresser l’humanité. Les centres de données consomment certes plus d’énergie, mais leur efficacité s’améliore. Comparée à d’autres secteurs, l’empreinte carbone de l’IA reste contenue.
⚖️ Une régulation intelligente s’impose : pas une interdiction paralysante, mais un cadre évolutif qui arbitrerait les risques d’usage… et de non-usage. Dans des domaines sensibles comme la santé ou l’éducation, l’IA peut être décisive. Plutôt que d’opposer l’IA à une humanité idéalisée, mieux vaut la confronter aux alternatives réelles – souvent imparfaites.
📰 Le journalisme illustre bien cette tension. Si les rédactions s’interrogent encore publiquement sur l’usage éthique de l’IA, de nombreux journalistes s’en servent déjà discrètement pour améliorer leur travail. Comme la calculette a libéré les mathématiciens, l’IA pourrait libérer les journalistes du labeur pour recentrer leur métier sur l’essentiel : comprendre, analyser, raconter.
🧠 Et si, loin d’affaiblir la pensée, l’IA nous poussait à plus d’esprit critique ? Une étude récente montre qu’un dialogue avec ChatGPT peut faire évoluer des croyances ancrées, non par confrontation directe, mais en engageant un raisonnement empathique. Loin de nourrir la désinformation, l’IA peut ainsi accompagner des transitions intérieures.
❓Finalement, si cet article a été co-écrit avec l’aide d’une IA, cela le rend-il moins pertinent ? Le jugement devrait-il porter sur l’outil… ou sur la valeur des idées qu’il permet d’exprimer ? Et si l’IA, bien utilisée, devenait un levier d’émancipation intellectuelle, un allié pour des transitions plus justes, critiques et éclairées ?
#IntelligenceArtificielle #EspritCritique #TransitionsÉcologiques #InnovationResponsable #Journalisme #PhilosophieTech #IApositives
L’IA, fin du règne du verbe et accélérateur d’idées
Entre peurs irrationnelles et opportunités transformatrices
Vers une régulation éclairée, pas paralysante
Un levier de pensée critique et d’émancipation
L’IA, fin du règne du verbe et accélérateur d’idées
Longtemps, la maîtrise du langage, du style et des outils conceptuels a permis à certaines personnes de monopoliser l’attention et d’exercer une autorité parfois imméritée. L’IA remet en question cette dynamique en rendant accessible à tous des capacités rédactionnelles et analytiques d’un haut niveau d’exigence. Désormais, la valeur d’un raisonnement ne tient plus à l’habileté rhétorique ou à la technicité du vocabulaire employé, mais bien à la solidité des idées qu’il défend.
Dans cette perspective, l’IA agit comme un catalyseur de clarification et de discernement. Là où l’affaire Sokal[1] a mis en lumière l’usage manipulateur du jargon pour conférer une aura artificielle de profondeur intellectuelle, l’IA, en démocratisant l’accès aux outils de structuration et d’argumentation, démasque l’esbroufe. Elle permet de concentrer l’attention collective sur la pertinence des contenus, en accélérant la chute des idées faibles et en propulsant les propositions réellement transformatrices.
Dans le cadre des transitions que nous devons opérer – écologiques, sociales, économiques – cette révolution cognitive ouvre des perspectives inédites. Elle redonne à chacun la capacité de participer activement aux débats et de proposer des solutions sans être entravé par des barrières de langage ou de rhétorique. Finalement, comme le soulève le professeur de stratégie Philippe Silberzahn, l’IA ne représenterait-elle pas la chance des moins qualifiés[2] ?
Entre peurs irrationnelles et opportunités transformatrices
De manière générale, il est essentiel de ne pas tomber dans le piège du biais de négativité[3], qui consiste à se focaliser davantage sur les risques et les dérives de l’IA (atteintes aux données personnelles, manipulation via les deep fakes, pertes d’emplois redoutées) plutôt que sur ses immenses opportunités. Comme le souligne encore Philippe Silberzahn, l’automatisation a toujours suscité des craintes[4], mais elle a historiquement conduit à une augmentation de la productivité, à une expansion des marchés et à la création de nouveaux emplois. De même, l’IA n’a pas vocation à remplacer les humains, mais à être un outil puissant qui démultiplie nos capacités. Plutôt que de céder à la crainte ou à l’attentisme, nous devons apprendre à l’intégrer intelligemment pour maximiser son potentiel transformateur.
Un autre aspect souvent évoqué est l’impact énergétique de l’IA[5]. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie, la consommation des centres de données représente aujourd’hui environ 1 à 2 % de la demande mondiale d’électricité. Si l’essor de l’IA entraîne une augmentation de cette consommation, elle reste cependant contenue grâce aux gains d’efficacité technologique. Depuis 2008, l’intensité énergétique des puces informatiques a diminué de plus de 99 %, permettant d’absorber la croissance des usages sans explosion énergétique. Selon un récent rapport de Goldman Sachs Research[6] qui examine l’impact de l’essor de l’intelligence artificielle, la part de la consommation électrique mondiale attribuée aux centres de données pourrait atteindre 3-4 % d’ici à 2030, tandis que leurs émissions de CO₂ devraient plus que doubler, atteignant 0,6 % des émissions énergétiques mondiales. Cela dit, bien que les modèles d’IA consomment davantage qu’une recherche classique sur Internet, leur impact global demeure inférieur à celui d’autres secteurs comme l’industrie, les transports ou encore la climatisation qui, à titre d’exemple, consomme 10 % de la demande mondiale d’électricité[7]. La question énergétique doit donc être abordée avec nuance, en prenant en compte les efforts d’optimisation et d’investissement des entreprises technologiques dans les énergies bas carbone.
Vers une régulation éclairée, pas paralysante
Enfin, il est essentiel d’adopter une approche équilibrée de la régulation de l’IA. Pour être raisonnable, celle-ci devrait être contrefactuelle en pesant les pour et les contres et non pas se cacher derrière un principe de précaution dogmatique. Toute réglementation sensée se doit de reposer sur un arbitrage entre les risques d’utilisation et les risques de non-utilisation[8]. Un excès de prudence peut freiner des avancées majeures, notamment dans des domaines comme la médecine où l’IA permet d’accélérer la recherche et d’améliorer la prise en charge des patients. Comme le souligne le philosophe des sciences Maarten Boudry, la précaution implique parfois d’agir[9] et l’adage selon lequel il ne faudrait pas agir s’ il existe un risque n’est tout simplement pas réaliste car comme il le dit : Il arrive que sauter soit plus sûr que rester immobile. Nous ne devons pour autant pas ignorer qu’elle peut causer du tort comme par exemple le pilotage d’une voiture autonome qui serait responsable d’un accident. Si la réglementation doit assurer un usage éthique et sécurisé, elle ne doit pas étouffer l’innovation en imposant des contraintes disproportionnées. Comparer l’IA à une situation idéale et irréaliste empêche de mesurer son véritable impact par rapport aux alternatives humaines, souvent imparfaites. Une approche pragmatique et évolutive est donc nécessaire pour maximiser ses bénéfices tout en maîtrisant ses risques.
Pendant que le débat sur l’utilisation de l’IA occupe les comités de rédaction[10] dans la presse, de nombreux journalistes l’emploient déjà au quotidien, souvent discrètement et sans l’assumer publiquement. Par crainte des critiques ou de réprobations internes, certains jeunes journalistes préfèrent ne pas révéler qu’ils s’appuient sur ChatGPT ou d’autres outils d’IA pour structurer leurs articles, proposer de nouvelles perspectives, reformuler des passages ou même rédiger des contenus entiers. Cette situation fait qu’une confusion persiste quant au cadre éthique et déontologique entourant ces pratiques : tandis que certaines rédactions encadrent strictement l’usage de l’IA, d’autres l’interdisent officiellement tout en tolérant implicitement son recours en coulisses. Ce paradoxe révèle une transition en cours dans le journalisme, où l’IA, plutôt que d’être perçue comme une menace, pourrait être reconnue comme un atout professionnel légitime.
Un levier de pensée critique et d’émancipation
Dans cette perspective, déjà en avril 2023, dans son article IA, la nouvelle machine à écrire[11], Antoine Bueno défendait l’idée que, tout comme l’arrivée de la machine a libéré les mathématiciens du labeur de certains calculs, l’IA libère les journalistes d’un travail rédactionnel répétitif, leur permettant ainsi de recentrer leur métier sur l’analyse et la créativité. À l’instar de la calculette, qui n’a pas tué les mathématiciens, mais leur a permis d’aller plus loin, ChatGPT est un outil d’aide à l’écriture plutôt qu’un fossoyeur du journalisme et de la littérature. Bien qu’elle pose un défi aux écrivains, bluffés par sa créativité[12], elle ne remplace pas leur âme. De même, bien que les deepfakes soient inquiétants, ils pourraient renforcer notre esprit critique face aux images et accélérer une évolution anthropologique de notre rapport au réel[13]. Tout comme l’imprimerie a forcé à distinguer le vrai du faux en apprenant que tout ce qui est écrit n’est pas la vérité, la prolifération d’images falsifiées pourrait nous rendre plus vigilants. Loin d’annoncer un effondrement de la pensée, l’IA pourrait au contraire être un levier d’émancipation intellectuelle, nous obligeant à redéfinir nos exigences de vérité et de discernement. Ceci dit, cela ne répond pas à toutes les interrogations que provoque l’utilisation de l’IA, notamment à la question légitime de préjudice morale soulevée par de nombreux artistes [14] par exemple.
En envisageant l’IA comme un outil d’émancipation intellectuelle dont l’usage détermine les conséquences, Antoine Bueno ne croyait pas si bien dire. Contrairement à l’idée répandue selon laquelle les complotistes seraient crédules, un article du magazine Psyche[15] met en avant leur engagement actif dans la recherche d’informations et la construction d’arguments sophistiqués. La quête de découverte et le plaisir intellectuel que nous tirons de nos recherches personnelles jouent un rôle clé dans notre adhésion à différentes théories. À ce titre, une étude en preprint de 2024[16] a montré que des interactions avec ChatGPT-4 Turbo ont modifié de manière significative et durable les croyances de personnes adhérant à certaines théories. Plutôt que de simplement opposer des faits aux idées reçues, le modèle a engagé un raisonnement avec les utilisateurs, questionnant leurs postulats et stimulant leur esprit critique. Ce dialogue a permis un repositionnement progressif des croyances, en s’appuyant sur l’expérience individuelle des participants. Loin d’encourager la désinformation, l’IA, en s’adaptant aux vécus des individus, peut donc favoriser l’esprit critique et aider à s’affranchir des dogmes. »
D’ailleurs, le fait que cet article ait été rédigé à l’aide de l’intelligence artificielle lui ôte-t-il sa pertinence ? Ce mode de production remet-il en cause la crédibilité des idées qui y sont développées ? Si tel n’est pas le cas, pourquoi serait-on gêné par un outil qui, bien utilisé, améliore nos capacités discursives ? Est-ce réellement son usage qui pose problème, ou plutôt l’idée que l’on s’en fait ? Dès lors, plutôt que de voir dans l’IA une menace pour la pensée critique, ne devrait-on pas l’envisager comme un levier d’approfondissement et d’émancipation intellectuelle ? Dans ces conditions, ne serait-il pas un levier d’accélération des transitions justes et éclairées ?
Jonathan Guéguen avec Chat GPT
[1] Nicolas Journet, « L’affaire Sokal : pourquoi la France ? », Sciences Humaines, 2005.
[2] Philippe Silberzahn, « Et si l’IA était la chance des moins qualifiés ? », Philippe Silberzahn Blog, 2023
[3] Laurent Bègue-Shankland, « Phébé – Pourquoi nous prêtons plus attention au négatif qu’au positif, » Le Point, 2020.
[4] Philippe Silberzahn, « Les sept raisons pour lesquelles vous êtes déjà en train de rater le virage de l’IA », Philippe Silberzahn Blog, 2023.
[5] Hannah Ritchie, « What’s the impact of artificial intelligence on energy demand? », Sustainability by Numbers, 2024.
[6] Goldman Sachs Research, AI/Data Centers’ Global Power Surge: The push for the ‘Green’ data center and investment implications, 2025.
[7] Howarth, N., Camarasa, C., Lane, K., & Risquez Martin, A., Keeping cool in a hotter world is using more energy, making efficiency more important than ever, Agence Internationale de l’Énergie, 2023.
[8] Philippe Silberzahn, « Cinq principes pour réglementer intelligemment l’IA », Philippe Silberzahn Blog, 2024.
[9] Maarten Boudry, « Il est temps d’enterrer le principe de précaution », Le Point, 2021.
[10] Coppélia Piccolo et Florian Gouthière, « « J’ai écrit 20 lignes et ChatGPT m’a fait les 40 autres » : comment l’IA modifie les pratiques des journalistes, » Libération,2025.
[11] Antoine Buéno, « IA, la nouvelle machine à écrire, » Libération, 2023.
[12] William Galibert, « Quand l’écrivain Hervé Le Tellier affronte ChatGPT : l’IA va-t-elle tuer la littérature ? », RTL, 2023.
[13] Antoine Buéno, « Les deepfakes, une révolution spirituelle, » L’Opinion, 2024.
[14] Sigal Samuel, The Artist’s Best Argument Against AI, newsletter Future Perfect, Vox, 2025
[15] Stephen Gadsby & Sander Van de Cruys, « The surprising role of deep thinking in conspiracy theories, » Psyche, 2024.
[16] Costello, T. H., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2024). Durably reducing conspiracy beliefs through dialogues with AI.



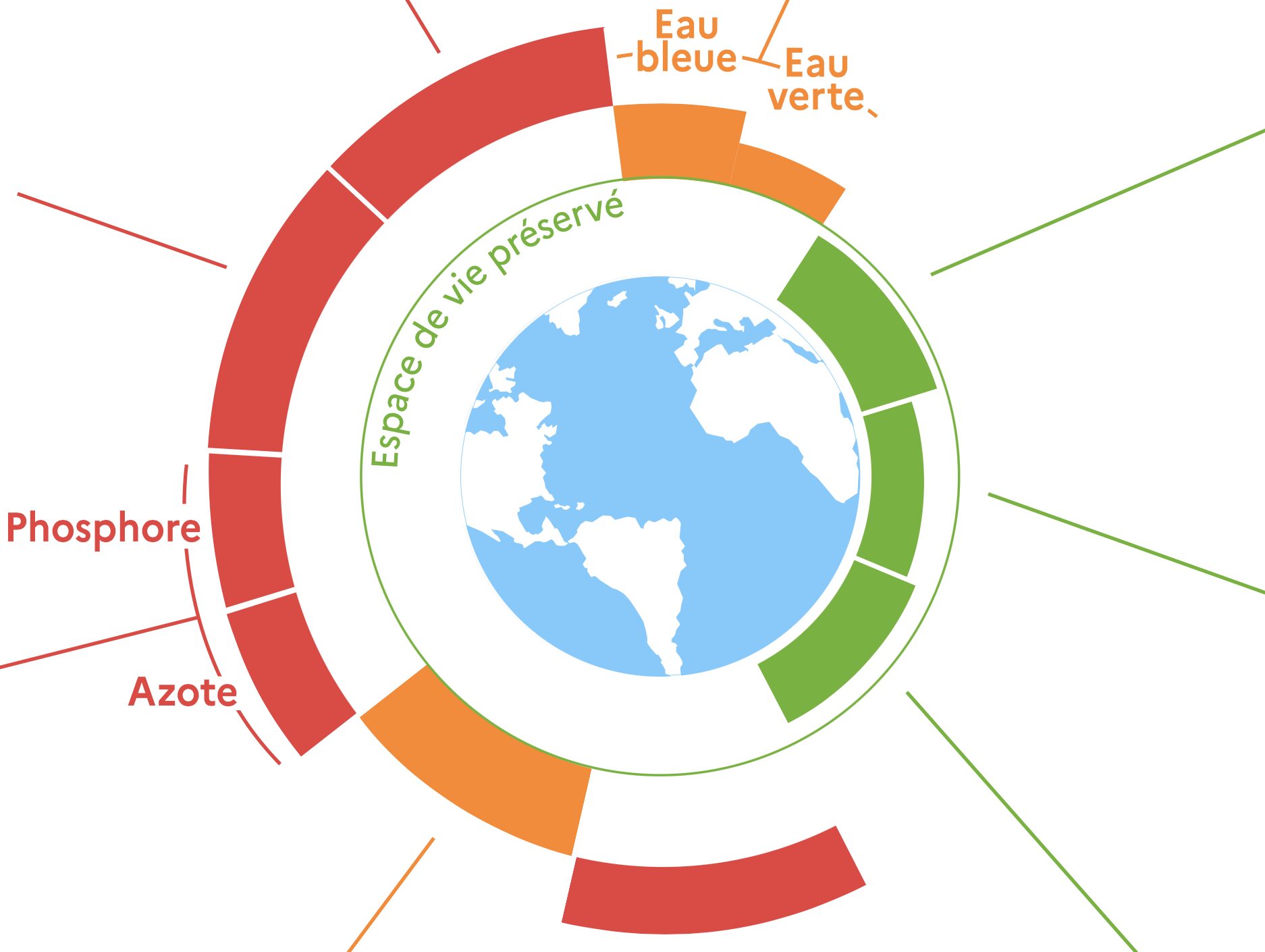



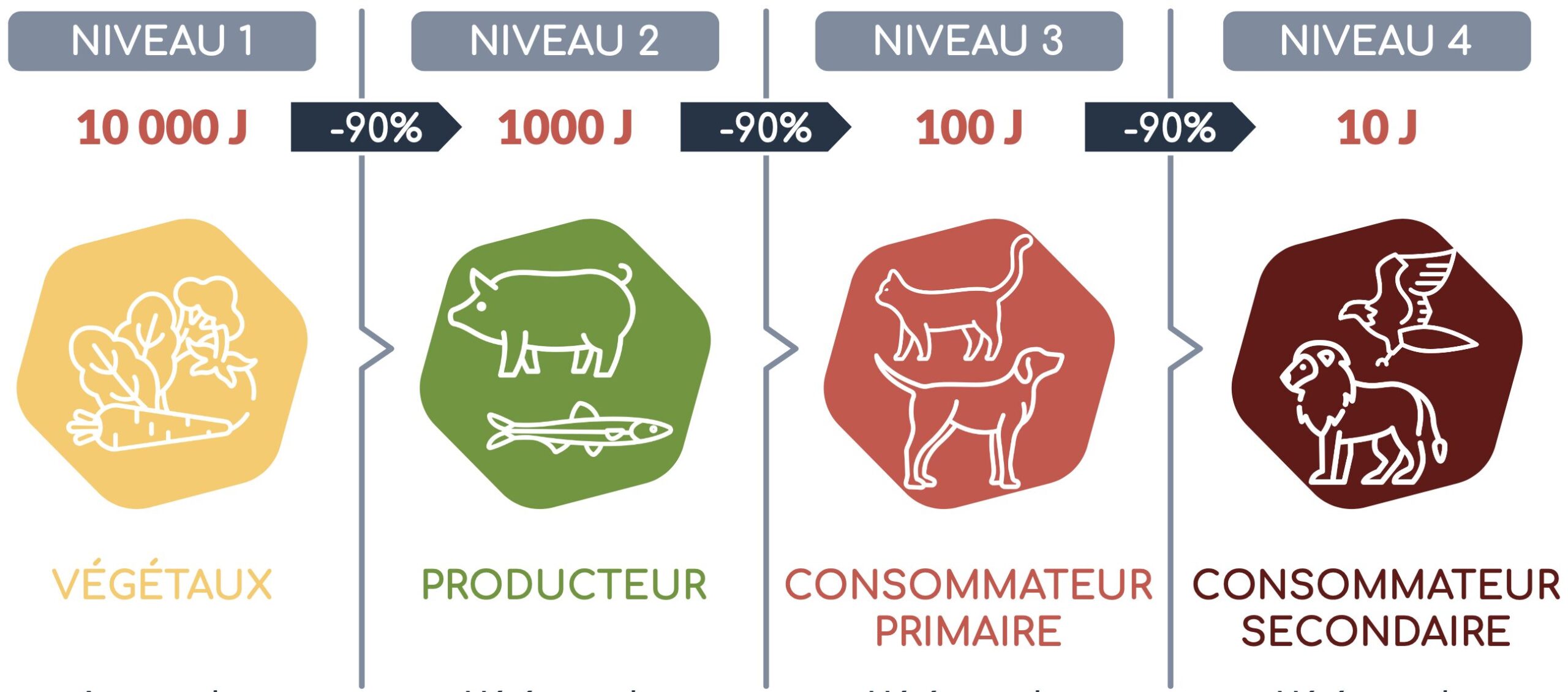

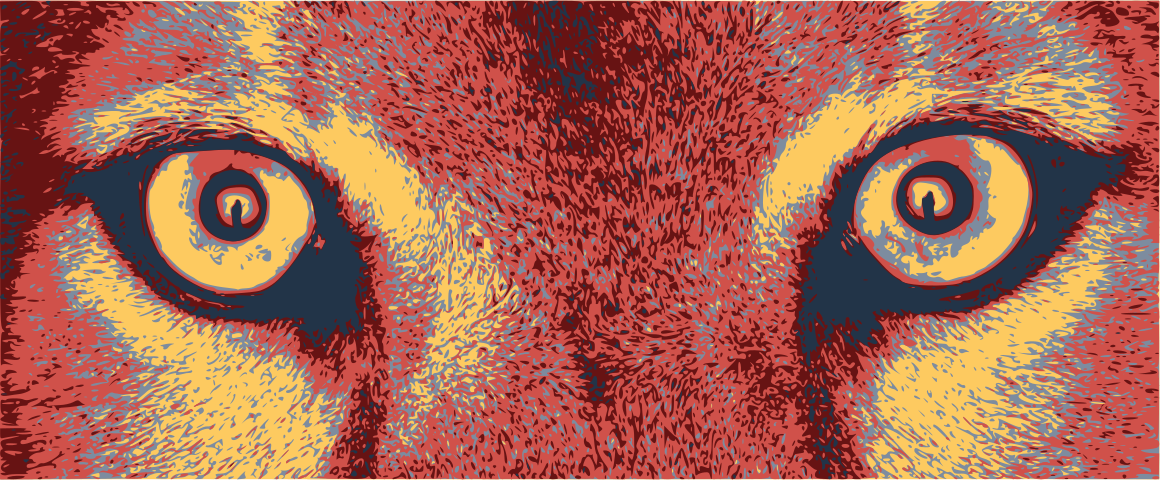


0 commentaires